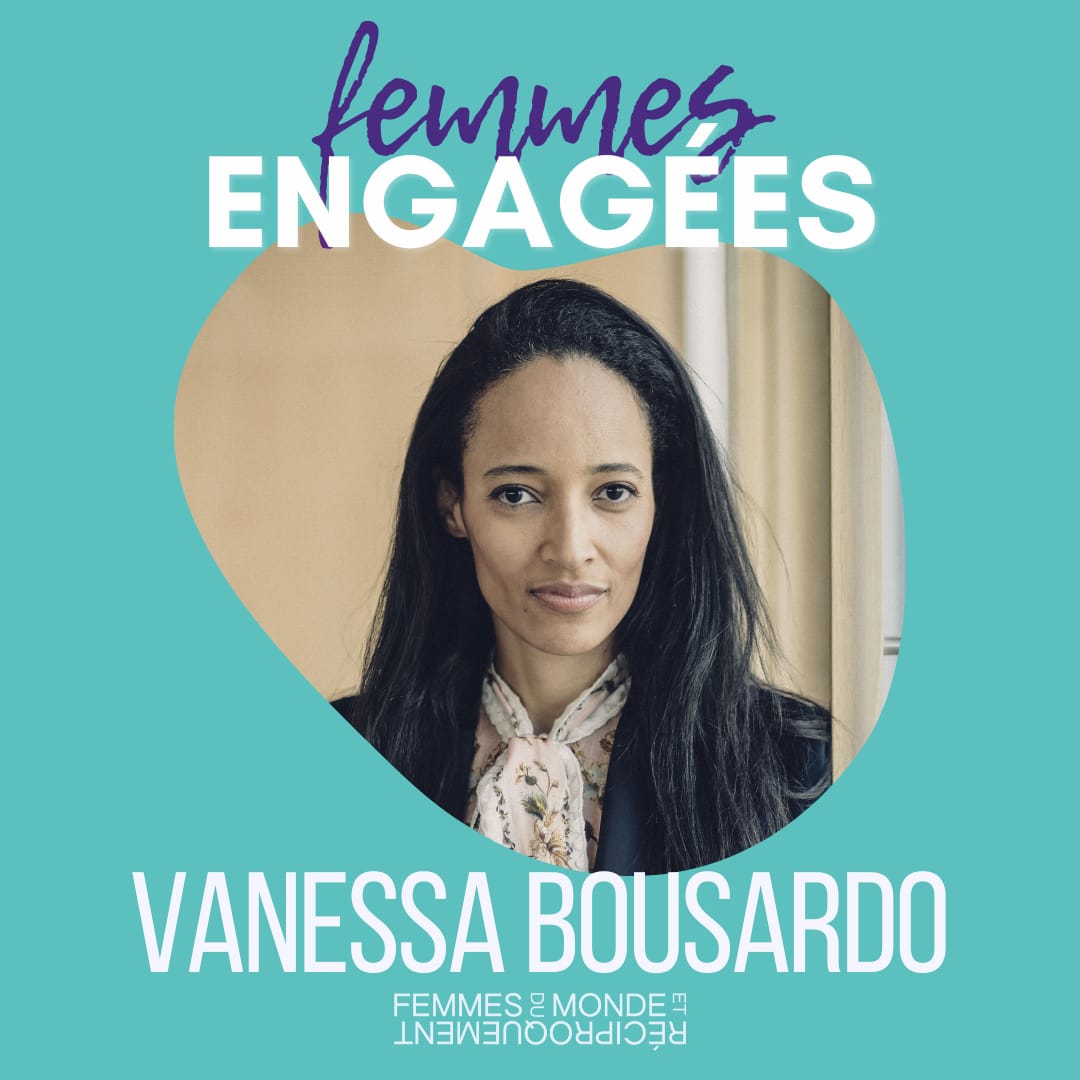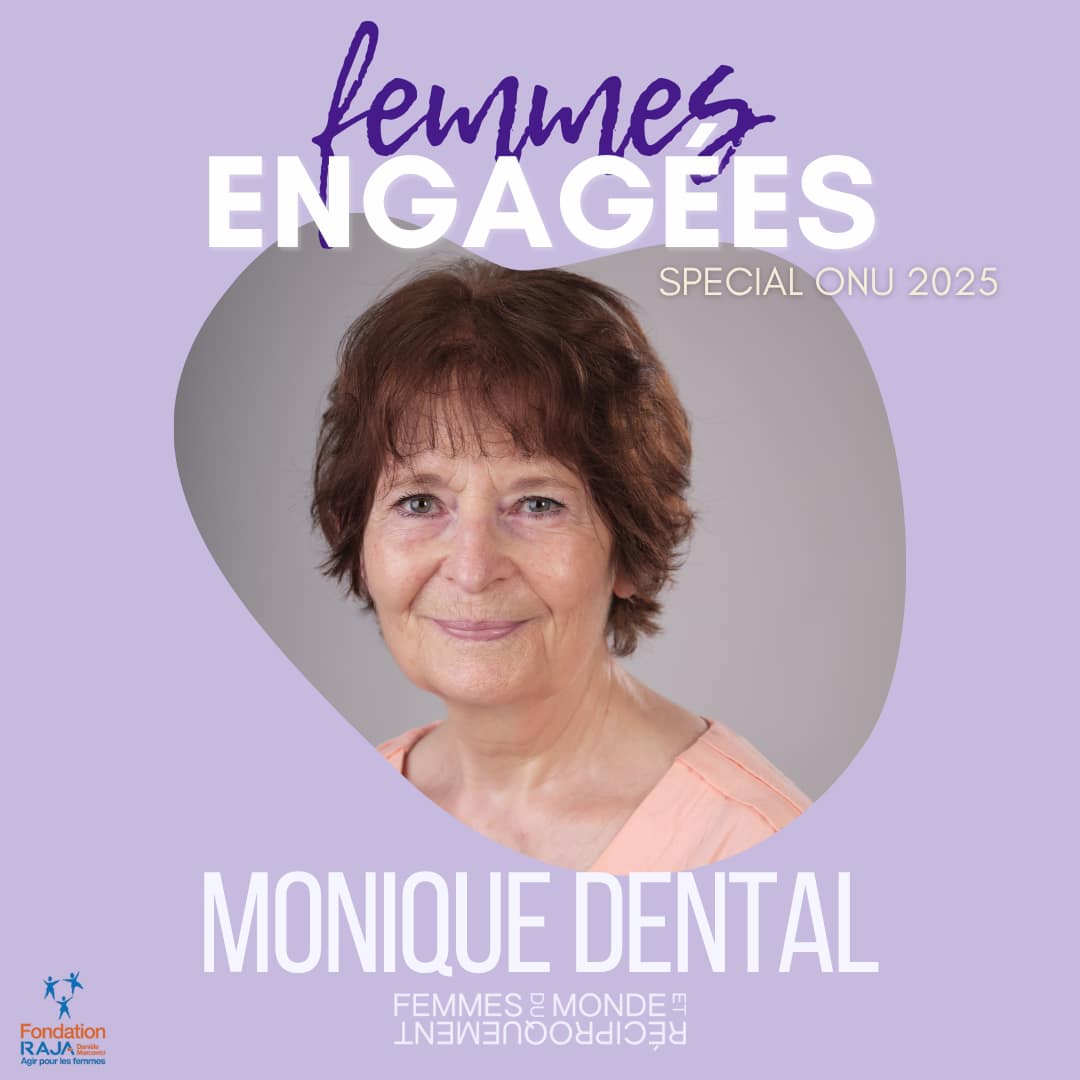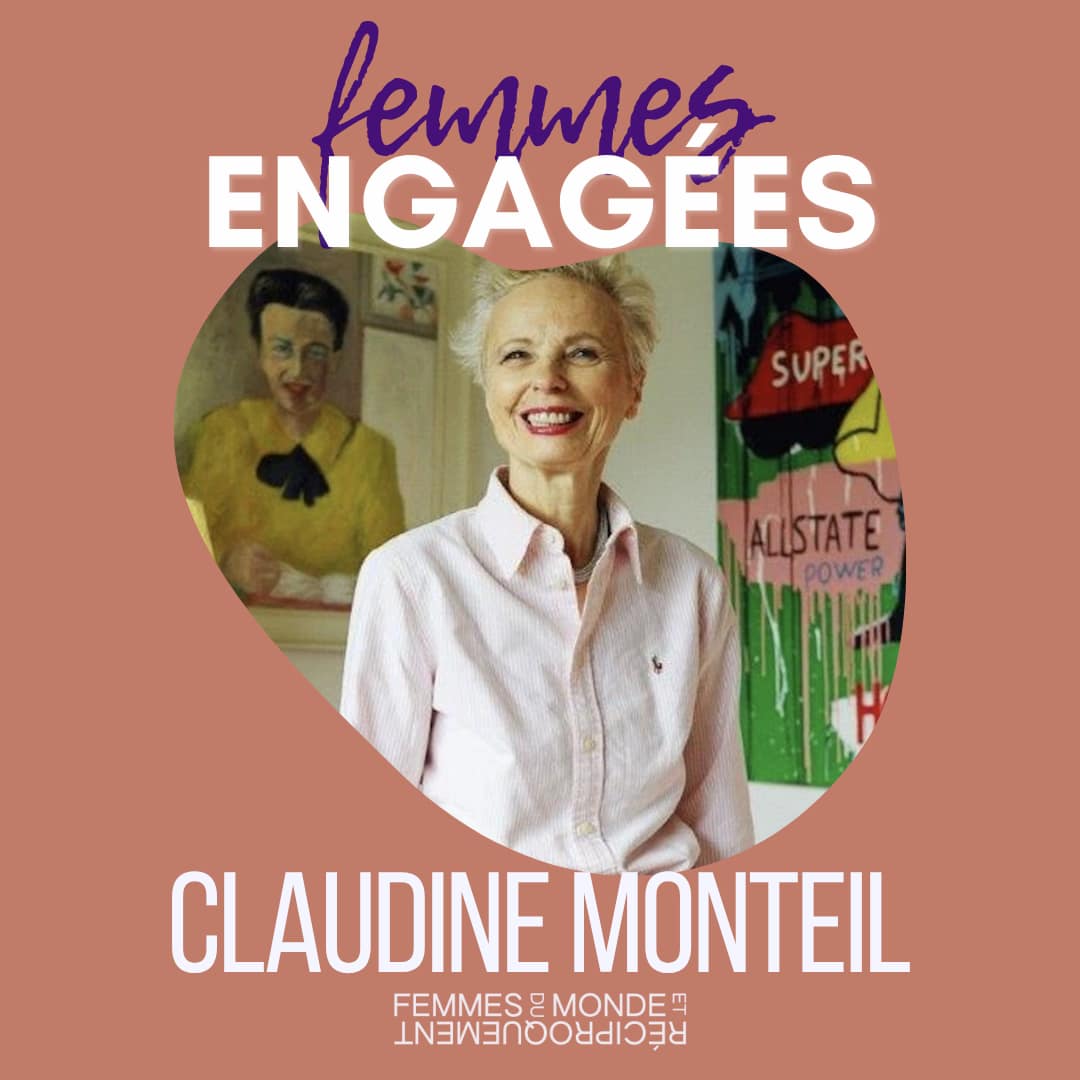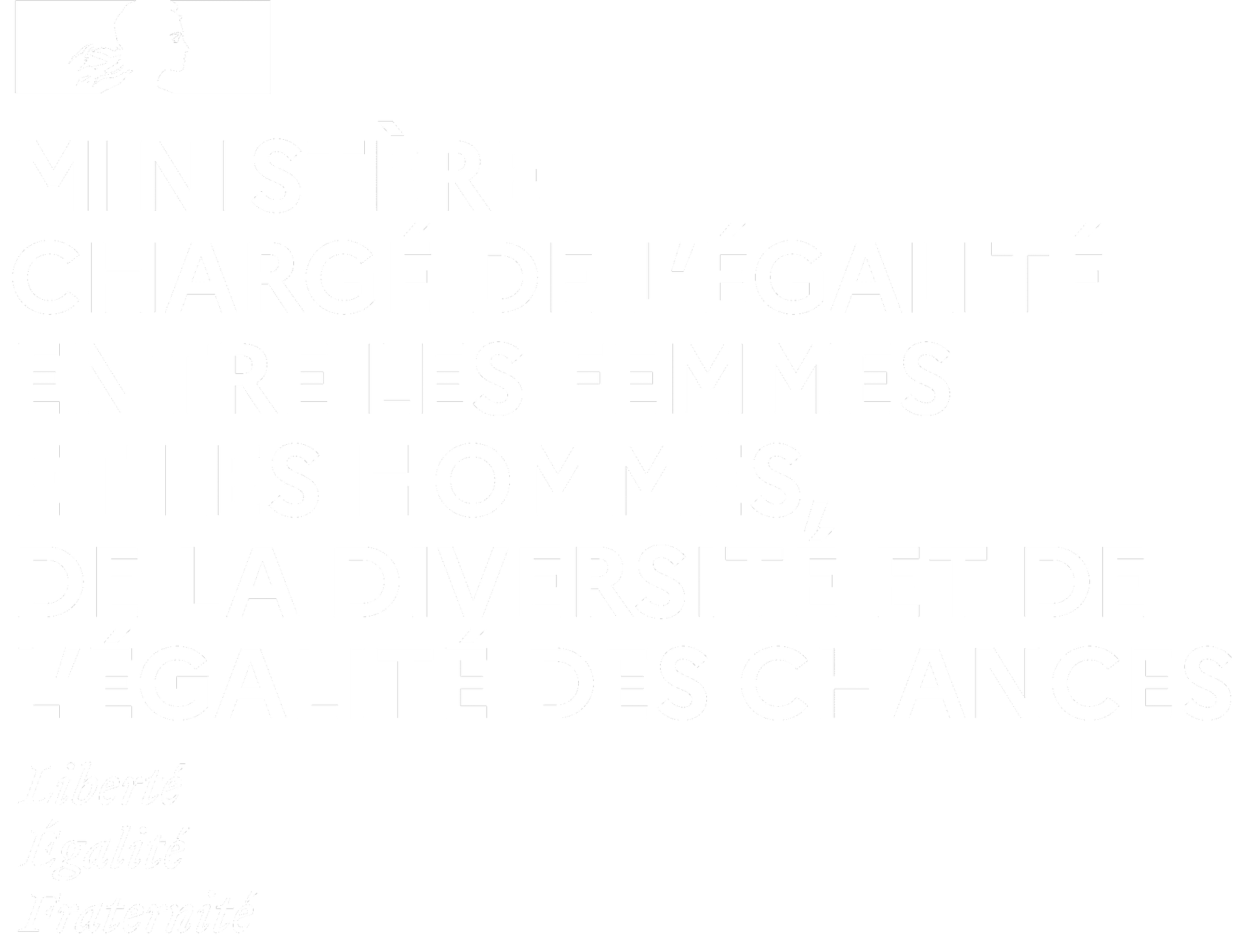Anne Cécile Robert est directrice adjointe du Monde diplomatique, enseignante et essayiste. Face aux bouleversements du monde et aux risques d’une troisième guerre mondiale, cette spécialiste des institutions européennes et internationales, comme l’ONU, qui a écrit plusieurs livre, nous rappelle dans cet entretien les valeurs pacifistes et humanistes qui constituent sa grille de lecture du monde, son engagement pour la réhabilitation de la paix et sa foi dans le pouvoir de la société civile. Anne-Cécile Robert, vous co-dirigez Le Monde Diplomatique, le journal français le plus diffusé au monde avec ses 36 éditions dans 27 langues. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette institution du journalisme qui tient une place à part dans la presse nationale et internationale ? Le Monde diplomatique est un mensuel du groupe Le Monde, fondé il y a plus de 70 ans et destiné à l’origine aux ambassades. Depuis une trentaine d’année, il dispose de sa propre rédaction, de ses structures juridiques et de son projet éditorial. Le Monde diplomatique suit l’actualité internationale sans écarter aucun aspect, outre la dimension diplomatique et les relations internationales, il intègre aussi l’économie, le social, la culture, l’histoire. Nous refusons de courir après l’actualité immédiate et choisissons au contraire de prendre le temps de la réflexion et du recul, y compris historique. D’ailleurs notre devise est : « On s’arrête, on réfléchit ». Nous faisons aussi appel à des contributeurs d’horizons divers et sommes dans une approche pluridisciplinaire. Nous avons deux grandes préoccupations : d’une part, être un journal de contre-information, afin de fournir une information qu’on ne trouve pas forcément ailleurs et d’autre part, analyser et critiquer les rapports de domination quels qu’ils soient : Nord/Sud, colonial, mais aussi économique, sociale et, évidemment, de domination des hommes sur les femmes. Je pense que notre lectorat nous est fidèle pour cette constance dans nos lignes directrices et nos valeurs humanistes. Comment et pourquoi avoir choisi Le Monde diplomatique et les enjeux internationaux ? Au départ, je ne me destinais pas du tout au journalisme, mais à l’université. Je suis docteure en droit européen, mais dès mes années lycée j’ai été une grande lectrice du Monde diplomatique. J’ai eu la chance de faire la connaissance de Bernard Cassen (1), qui malheureusement vient de nous quitter. Directeur du Monde diplomatique, il m’a dit un jour : « il y a une place pour toi si ça t’intéresse”. Je n’ai pas hésité une seconde, parce que c’était le Monde diplomatique et ce projet éditorial, sinon je ne serais pas devenue journaliste. D’ailleurs, je n’ai jamais abandonné l’université : j’enseigne à l’IRIS, j’ai été professeure associée à l’Institut européen de l’Université Paris 8 pendant 20 ans et j’enseigne aujourd’hui à Paris 2. Journalisme et enseignement sont des formes de transmission, comme les livres que j’écris, c’est un tout. Mais j’apprécie énormément d’être au Monde diplomatique parce que c’est un espace de liberté essentiel. Il y a peu de journaux où l’on peut s’exprimer librement. J’aime cette possibilité qui m’est offerte d’écrire des articles longs avec des sources, comme dans les revues universitaires. Je pense donc continuer comme ça, à la fois au Monde diplomatique et à l’université, c’est assez cohérent. J’aimerais revenir sur votre dernier livre Le défi de la paix : remodeler les organisations internationales. Sur une planète qui semble s’engouffrer dans la guerre, comment fait-on pour préserver une paix mondiale de plus en plus en fragile, face à certains gouvernants fauteurs de guerre (tous des hommes d’ailleurs) qui prônent la force au détriment du droit international ? Comment revaloriser les notions de paix et d’humanisme et réformer les organisations internationales, à commencer par l’ONU ? Il y a plusieurs aspects… La première chose est de formuler le bon diagnostic, sinon on ne peut pas apporter les bonnes réponses. Je le développe dans Le défi de la paix. Nous sommes à la fin d’un cycle historique : on vit un changement politique, géopolitique, juridique mais aussi philosophique. C’est quelque chose d’extrêmement profond qui fait tout vaciller sur ses bases : l’ordre mondial né après 1945 risque de disparaître pour être remplacé par un autre, peut-être plus chaotique. La deuxième chose, c’est de poser ce diagnostic de manière juste. Pendant des années, ça a été “un sport national”, voire un sport international, de dire du mal de l’ONU. Il y a eu des articles, des livres pour expliquer à quel point ça ne marchait pas, pour critiquer sans nuance, détruire. Certes, l’ordre international dans lequel nous sommes depuis 80 ans a des défauts. Il a notamment abrité la domination des deux super grands, les Etats-Unis et l’Union Soviétique. C’est vrai que l’ONU est bureaucratique, que le Conseil de sécurité est paralysé par le droit de véto. C’est vrai qu’il y a eu et qu’il y a toujours des échecs : aujourd’hui l’ONU est impuissante à arrêter la guerre en Ukraine comme à Gaza. Mais il faut aussi dire que le système a fonctionné pendant 80 ans. Tout d’abord, il a rempli sa mission fondamentale : éviter la Troisième Guerre mondiale. Une ou deux fois, nous sommes passé·es à quelques heures de son déclenchement et c’est grâce à l’ONU, entre autres, que nous l’avons évité. Pendant 80 ans, l’ONU a permis la coopération internationale, a créé des programmes humanitaires, distribué des milliards d’aide, permis la signature de milliers de traités pour la culture, le social, le développement, le désarmement… ça a marché. Alors, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, voyons les choses avec justesse. Enfin la troisième chose, c’est l’une des raisons pour lesquelles on est en train de basculer dans des logiques de force, on a oublié les leçons de l’Histoire. On a beaucoup évoqué, invoqué le devoir de mémoire. Mais on a fait davantage de devoir de mémoire que de devoir d’Histoire. Si on sait qu’il y a eu la guerre, mais qu’on ne comprend pas ce qui a conduit à la guerre, les mécanismes politiques, historiques, économiques qui ont amené les puissances à faire la guerre, on ne se prémunit pas contre le retour de ces mécanismes. C’est le retour de logiques de force qu’on a connu dans le passé et que, malheureusement, notre défaut de transmission historique ne nous a pas permis de détecter plus tôt. Quelles sont ces logiques de force ? Elles sont de plusieurs ordres. Premièrement, on a des logiques de force liées au fonctionnement du système économique. On a vu depuis des années s’exacerber une course folle aux ressources, à l’énergie, aux terres rares. C’est l’un des carburants de la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine, par exemple, qui va mettre la main sur les ressources du Congo ou sur les microprocesseurs, les métaux rares? Or, quand ce n’est pas régulé, indépendamment des dégâts sur l’environnement, ça conduit à … Lire la suite