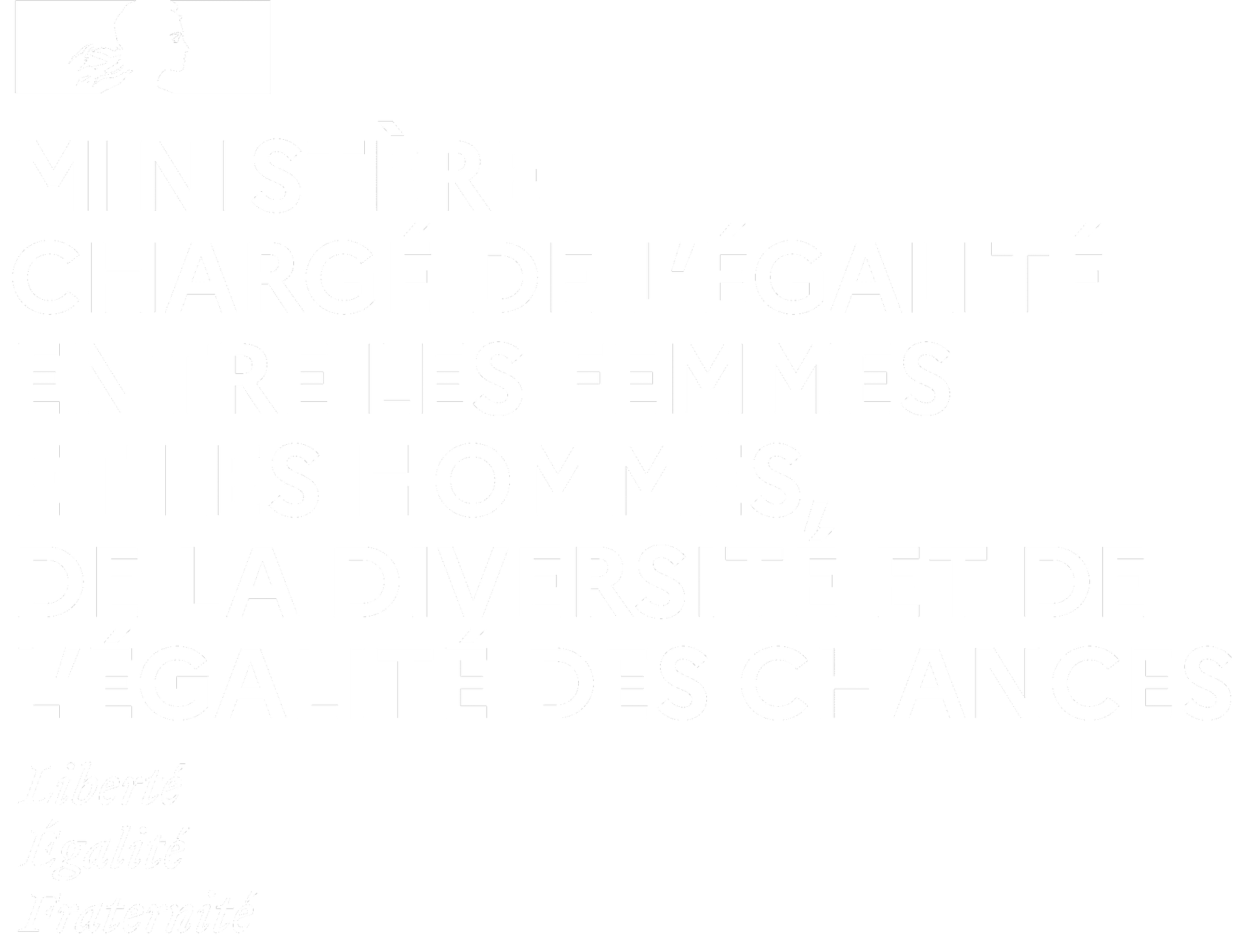Chronique Femmes du Monde : Européennes !
A la veille des élections européennes du 9 juin 2024, un petit tour de l’Union Européenne (UE) s’impose pour observer les droits des femmes dans cet espace de l’Europe et les enjeux de ce vote, dans le contexte de « brutalisation du monde » qu’on constate un peu plus chaque jour. L’Union européenne, c’est 27 Etats membres sur 54 pays pour le continent, quatre millions de kilomètres, 448 millions de citoyen·nes : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Comme tous les cinq ans, les Européens et Européennes de l’UE vont se rendre aux urnes pour élire cette année 720 parlementaires – dont 81 député·es françai·ses. Il faut reconnaître que ce scrutin est un peu celui du désamour. Celui que les Français·es dédaignent le plus. En particulièrement les femmes qui votent moins que les hommes lors de ces élections. C’est que cette entité semble lointaine, « techno », pas assez ancrée dans la vie réelle et quotidienne des gens. Et pourtant, selon que nous voterons en nombre ou pas, l’Europe engagera notre avenir dans un sens ou dans un autre, surtout lorsqu’on mesure la forte percée des populismes et des extrêmismes, qui devrait tous et toutes nous inquiéter… Et nous mobiliser. Les partis d’extrême-droite sont aujourd’hui en passe de remporter de nombreux sièges supplémentaires au Parlement européen. Or, lorsque ces forces arrivent au pouvoir on sait bien qu’elles n’ont de cesse de remettre en cause les droits des femmes et l’égalité. Certes, l’Europe reste le continent qui regroupe le plus grand nombre de pays classés en tête pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (PRIO), lequel place sur le podium dans l’ordre : l’Islande, la Norvège, la Finlande, la Nouvelle Zélande et la Suède. Dans la même idée des « bons élèves » européens, la France a récemment marqué l’histoire des droits des femmes le 8 mars dernier en inscrivant l’IVG dans sa Constitution, une première mondiale. Et l’association Choisir la cause des femmes, qui poursuit l’idée de Gisèle Halimi, proposant que les meilleures lois nationales des 27 Etats membres pour les femmes puissent s’appliquer à tous et bénéficier ainsi à toutes les Européennes, a réalisé une étude très intéressante à cet égard. Elle cite par exemple l’Estonie pour la mise en place de la meilleure éducation relationnelle, affective et sexuelle dans son système éducatif, l’Espagne pour sa politique globale de lutte contre les violences sexuelles ou son système de mariage et de divorce, la Finlande pour sa définition du viol et des violences sexuelles, le Danemark pour ses structures de garde, l’Allemagne pour la criminalisation de l’inceste sur enfants et adultes, Chypre pour l’imprescriptibilité du crime de viol, la Croatie sur l’indemnisation des victimes du viol de guerre, et d’autres encore. De quoi nourrir le rêve d’une Europe meilleure. Mais dans le même temps, l’Europe est partie intégrante de la dynamique internationale de recul des droits et elle est totalement interdépendante du reste du monde, dans une époque de profonde recomposition géopolitique. Si on regarde le globe terrestre, qu’est-ce qu’on voit ? Notre planète bleue l’est de moins en moins avec la pollution et le dérèglement climatique ; des régions entières des cinq continents sont à feu et à sang ; les conflits armés prolifèrent, 614 millions de femmes et de filles vivent dans un pays touché par des conflits (chiffres ONU 2022) ; 76 millions de personnes sont des déplacé·es internes et plus des deux-tiers sont, là encore, des femmes et des enfants ; le budget militaire mondial atteint le record historique de 2 243 milliards de dollars… On se prend à imaginer ce qu’on pourrait faire pour les droits des femmes et pour la paix avec cette manne ! Sur notre planète, les droits des femmes reculent au même rythme que reculent les démocraties tandis que les guerres et conflits augmentent au point qu’on en dénombre une centaine aujourd’hui. L’Europe n’y échappe pas depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Droits des femmes, Union européenne et diplomatie féministe. Depuis cette date, les Ukrainiennes subissent à nouveau toutes les violences sexospécifiques qui accompagnent systématiquement la guerre des hommes. Ce qu’elles avaient déjà dû subir en 2014, lors de l’annexion de la Crimée par la Russie, de la part des armées et milices aussi bien de Russie que d’Ukraine, à l’époque. Sans parler de la guerre, en Europe les femmes et leurs droits sont en danger dans bien des domaines. En Italie, l’accès à l’IVG est de plus en plus difficile, la majorité des gynécologues-obstétriciens refusant désormais de pratiquer des avortements en tant qu’« objecteurs de conscience ». En Pologne, malgré le changement politique l’avortement est dans les faits toujours aussi peu accessible. En Hongrie, on impose à présent aux femmes désireuses d’avorter d’écouter les battements de cœur du fœtus… La Hongrie toujours, avec cinq autres pays de l’UE, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la République tchèque ont refusé de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul – qui représente le texte international le plus abouti en matière de droits des femmes – au prétexte qu’elle aurait une approche idéologique du genre et serait une incitation à l’immigration. En Turquie, le chef de l’Etat a dénoncé ce traité en 2021 – dix ans après avoir été le premier à la signer en 2011 – et tend de plus en plus à effacer le principe d’égalité femmes/hommes au profit de celui de « complémentarité ». Même la Suède pourtant exemplaire en matière d’égalité, a abandonné la diplomatie féministe à la faveur de l’élection d’une coalition avec l’extrême droite. Décidément Simone de Beauvoir avait tellement raison de rappeler que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Heureusement, l’Union européenne a le pouvoir de faire progresser l’égalité femmes/hommes, qu’elle a placée parmi ses priorités. Elle a mis en œuvre une … Lire la suite